Cliquer ici pour télécharger l’intégralité de cet article.
Le 22 novembre 1970, les forces armées portugaises lancent une attaque contre la République de Guinée. Le coup de force échoue partiellement, mais va donner le coup d’envoi de la plus grande vague de répression de l’histoire de la Guinée à partir de 1971. Après plusieurs mois d’enquête historique, RFI raconte dans une série exclusive en 5 volets l’histoire de ces années, les plus sombres du régime d’Ahmed Sékou Touré. Dans le premier volet de cette enquête, revenons sur les origines du coup militaire préparé depuis Bissau, à l’époque toujours colonisée. L’idée de cette opération secrète est née dans un contexte difficile pour la dictature portugaise, qui est alors sous pression de la communauté internationale et mise en difficulté sur le sol de ses colonies. La situation va pousser quelques officiers à tenter le tout pour le tout.
À Conakry, une colonne coiffée d’une statue d’inspiration soviétique est la seule trace de l’opération Mar Verde. « La révolution est exigeante, l’impérialisme trouvera son tombeau en Guinée ! », peut-on lire sous le monument qui fait face au palais du peuple, l’actuelle Assemblée nationale. Presque chaque année, une poignée de fidèle de Sékou Touré s’y réunit pour honorer les victimes. « On ne parle jamais des 517 Guinéens qui ont péri ce jour », insiste un ancien des services de sécurité sous Sékou Touré, Mandifing Diané. Les 22 novembre, quelques articles de presse célèbrent également l’anniversaire. En Guinée, l’expression « agression des Portugais » est préférée à l’appellation militaire portugaise « opération Mar Verde ». Tout un symbole. Car il reste, dans l’imaginaire guinéen, chez les nostalgiques comme chez les antirévolutionnaires, l’idée d’une résistance du peuple face à des envahisseurs étrangers. « La riposte fut fulgurante et le peuple a largement mis en déroute les agresseurs », écrit guinéematin.com en 2016. La réalité est plus complexe. En démonter le mécanisme demande qu’on se replonge dans la géopolitique des années 60.
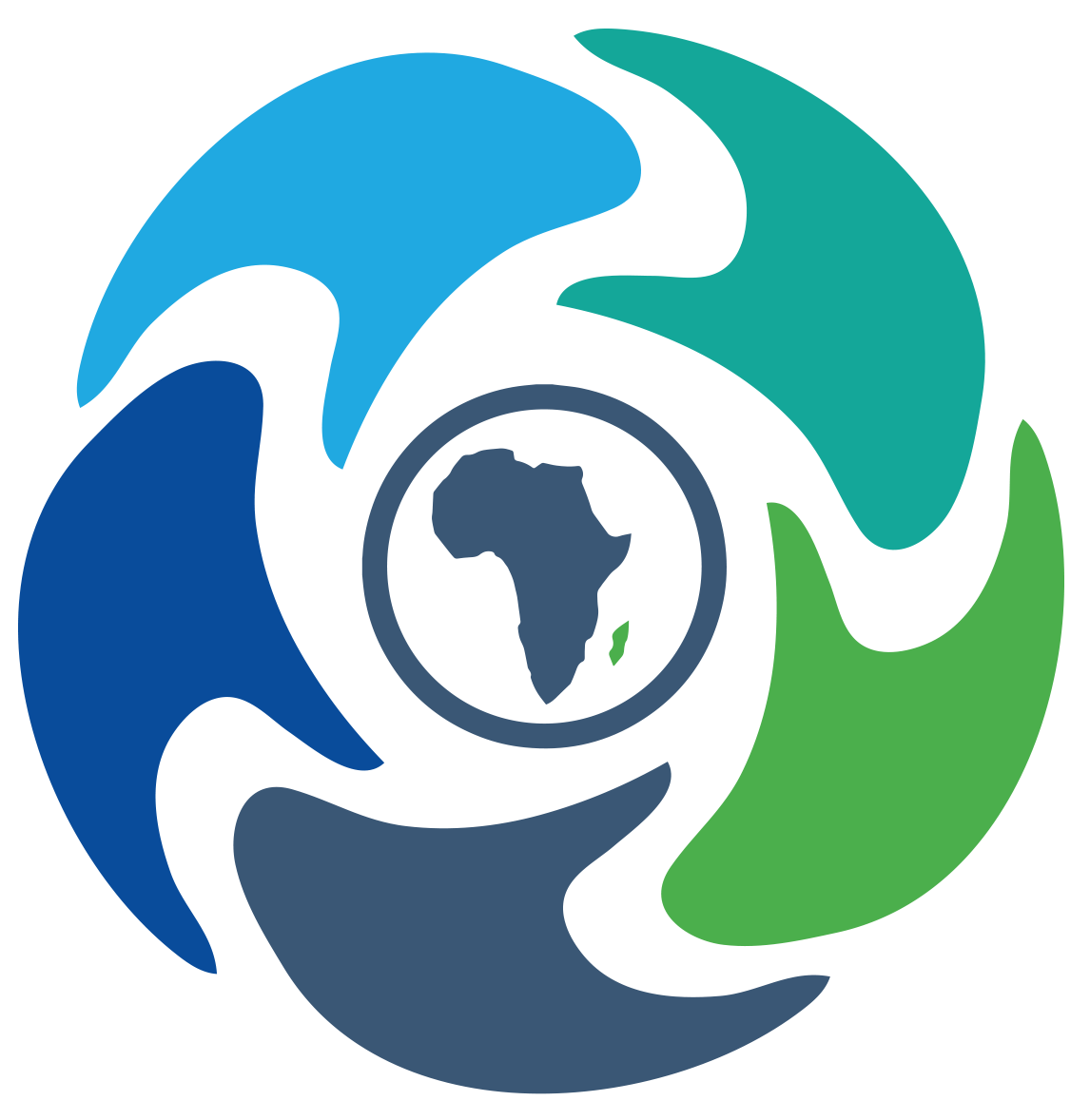


 Entre 1961 et 1974, le Portugal est l’un des pays les plus pauvres d’Europe. Pourtant, il mène une guerre contre des ennemis multiples dans 3 pays différents. Une guerre qui coûtera la vie à près de 9 000 de ses soldats. Le régime dictatorial de Salazar ne veut rien lâcher. Selon l’historienne Armelle Enders
Entre 1961 et 1974, le Portugal est l’un des pays les plus pauvres d’Europe. Pourtant, il mène une guerre contre des ennemis multiples dans 3 pays différents. Une guerre qui coûtera la vie à près de 9 000 de ses soldats. Le régime dictatorial de Salazar ne veut rien lâcher. Selon l’historienne Armelle Enders
Les commentaires sont fermés.