Né à Faranah (Guinée orientale) dans une famille musulmane modeste de l’ethnie malinké, Ahmed Sékou Touré, fréquente une école technique française à Conakry mais en est expulsé au bout d’un an, en 1936, pour avoir protesté contre la mauvaise qualité de la nourriture donnée aux élèves. En 1940 il est engagé comme employé de bureau, puis occupe, l’année suivante, un emploi administratif au service des postes. Il commence alors à manifester un grand intérêt pour le mouvement ouvrier et devient secrétaire général du Syndicat des travailleurs des P.T.T. créé par lui en 1945. Il participe à la fondation de la Fédération des unions ouvrières de Guinée, affiliée à la Fédération syndicale mondiale, et en deviendra plus tard vice-président. Il assiste à Paris au congrès de la C.G.T. en 1946.
Sékou Touré prend une part active aux affaires politiques après la fondation par Félix Houphouët-Boigny du Rassemblement démocratique africain (R.D.A.). En 1951, il prend la tête du Parti démocratique de Guinée (P.D.G.), section territoriale du R.D.A., et organise, en 1953, une grève générale des travailleurs de Basse-Guinée qui contraint, pour la première fois dans l’histoire africaine, l’administration française à céder. Battu aux élections législatives à l’Assemblée nationale française de 1951, il est élu conseiller général en 1954, maire de Conakry en 1955 et enfin député en 1956. À la fin de 1957 il devient vice-président du Conseil exécutif de Guinée. Grâce au P.D.G., il renforce ses positions et sape le pouvoir des chefferies. Par ailleurs, sa dimension africaine s’affirme lorsqu’il devient secrétaire général de l’Union générale des travailleurs d’Afrique noire (U.G.T.A.N.). Quand, en 1958, De Gaulle propose aux territoires français un référendum relatif à l’octroi de l’indépendance, Sékou Touré fait une campagne active en faveur de l’indépendance immédiate, cela en dépit du mot d’ordre du R.D.A. qui préconise de répondre « oui » à la Communauté. Il affirme que son peuple « préfère la pauvreté dans la liberté plutôt que l’opulence dans l’esclavage ». Le 2 octobre 1958, la Guinée devient donc le premier État francophone indépendant d’Afrique noire, et Sékou Touré en est élu président peu de temps après. Il sera régulièrement réélu jusqu’en 1982.
La France réagit comme prévu, rompant tous les liens avec Conakry et rappelant tous ses techniciens et fonctionnaires. Malgré les tentatives de rapprochement de Sékou Touré, une méfiance réciproque empêche désormais la relance d’une véritable politique de collaboration. Menacé de faillite économique, le gouvernement guinéen accepte alors le soutien du camp socialiste, puis celui des pays anglo-saxons. Sékou Touré se définit lui-même comme un neutraliste positif, c’est-à-dire « un mélange curieux de pragmatisme, d’anticolonialisme et d’antisoviétisme ». Sa conception du développement emprunte largement au modèle soviétique et il a pu obtenir pour son pays l’aide de conseillers techniques russes. Toutefois, ses rapports avec les pays socialistes ont connu des phases successives de rapprochement et de tension. Quant au secteur minier, dont le développement permet de compenser en partie l’échec subi dans le domaine agricole, il demeure sous le contrôle des capitaux français et surtout américains.
Dans le domaine des affaires africaines, Sékou Touré apporte son soutien à Nkrumah et à son programme d’unification africaine ; mais l’union des deux nations, annoncée en 1958, n’aboutit pas. Sékou Touré crée avec les pays islamiques le bloc de Casablanca en 1961 ; par contre, son attitude entraîne l’échec de l’Organisation des États riverains du fleuve Sénégal (O.E.R.S.). Vivant dans une atmosphère de complot permanent, il ne quitte plus la Guinée pendant une vingtaine d’années ; une tentative avortée de débarquement à Conakry d’opposants appuyés par l’armée portugaise, en décembre 1970, l’incite à procéder à une nouvelle épuration des milieux politiques et à renforcer son pouvoir personnel. Toute forme d’opposition étant interdite, plus d’un million de Guinéens choisissent l’exil. Ainsi celui qui à partir de 1958 a été un symbole pour toute l’Afrique, a-t-il fini par s’identifier à un régime ressortissant plus de l’État policier que d’un modèle propre à entraîner le consensus populaire. Après qu’une atmosphère de chasse aux sorcières, renforcée par des dizaines de pendaisons publiques puis par la mise en accusation du Portugal, de l’Allemagne de l’Ouest, de la France et du Vatican, eut pesé sur la Guinée en 1970, Sékou Touré, qui avait alors composé un Adieu aux traîtres, oriente son action vers une aide accrue aux guérilleros d’Angola et de Guinée-Bissau. Puis, sans modifier le caractère de son régime, Sékou Touré a renoué des liens avec l’ancienne puissance coloniale et cherché à rompre l’isolement de son pays sur la scène internationale (visites du président français à Conakry en 1978 et du président guinéen à Paris en 1982 ; réconciliation avec le Sénégal et la Côte-d’Ivoire). Sékou Touré a reçu le prix Lénine de la Paix en 1960.
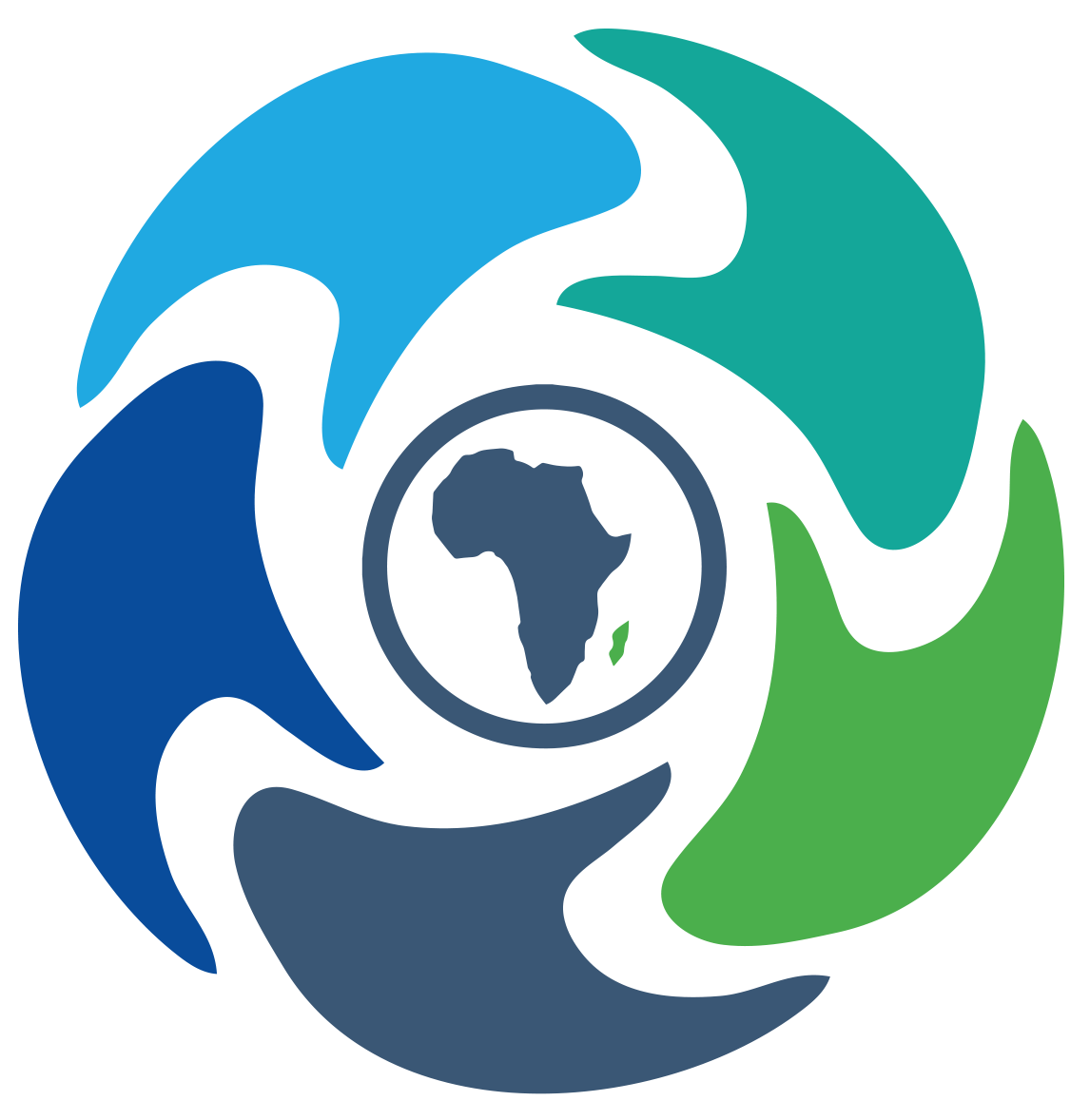


Les commentaires sont fermés.