Les autorités de Guinée portugaise sont mises en difficulté par l’insurrection du PAIGC (Parti Africain pour l’Indépendance de la Guinée et du Cap Vert) dont elles ne parviennent pas à contrer les opérations d’infiltration lancées depuis la Guinée. Le nouveau gouverneur militaire à Bissau, le général Antόnio de Spinola va tenter de renverser le rapport de force en organisant une opération inédite et secrète sur le territoire guinéen. Une opération qui nécessite des renseignements, des armes, des hommes et un plan d’attaque. Suite de notre enquête historique en cinq épisodes sur la répression de 1971 en Guinée… et le coup de force qui l’a déclenchée.
Le bateau bat pavillon du PAIGC, la rébellion de Guinée portugaise. Il est deux heures du matin. « Les lumières de la ville sont clairement visibles. Le navire passe entre les îles de Los et la péninsule, puis réduit sa vitesse. Le cabo fuzileiro António Augusto da Silva-Touré, képi de lieutenant-capitaine sur la tête, répond avec une contenance impeccable aux salutations des pêcheurs guinéens[1] », se souvient Alpoim Calvão. La mission consiste à mettre à jour les données disponibles sur le port de Conakry en vue d’une prochaine intervention militaire.
Aucun Européen n’est visible sur le pont. Depuis l’intérieur du navire, le commandant Calvão, chef du département des opérations spéciales et tête pensante de l’opération, est venu en personne diriger le repérage. « À trois heures du matin, le travail est terminée » note-t-il[2]. Le navire reprend la direction de l’autre Guinée, Soga plus précisément, une île de l’archipel des Bijagos. Le lieu où s’organise l’intervention. En ce 17 septembre 1970, les préparatifs sont résolument engagés, l’heure décisive approche.
Un enfant de l’Ultramar
Alpoim Calvão porte sur sa poitrine les plus hautes distinctions de l’armée portugaise, et sur son visage rond, une sempiternelle casquette de marin. Comme il le rappelle dans ses écrits, Alpoim est un enfant de l’Ultramar, « l’Outre-mer » composé des colonies portugaises de Guinée Bissau, d’Angola et du Mozambique. Il n’a qu’un an et deux mois lorsqu’il débarque à Lourenço Marques, 38 ans avant que la ville prenne le nom Maputo à la faveur de l’indépendance. Le jeune garçon se rêve en chevalier, s’imagine en Roland brandissant « [sa] bonne épée Durandal ! » [3]. Puis ses héros deviennent portugais : ce sont les grands généraux vainqueurs des campagnes d’Angola, de Guinée et du Timor.
En 1954, il est à l’école militaire lorsque lui parvient la nouvelle de la défaite française de Diên Biên Phu : « J’étais dans la salle des cadets quand la radio a annoncé la reddition de cette place forte de l’armée française en Indochine. J’étais stupéfait et j’ai pris conscience que quelque chose de nouveau venait de se produire dans l’art de la guerre »[4]. Calvão consacrera une grande partie de sa vie à lutter contre une guérilla de libération nationale, le PAIGC, et plus d’une année à préparer l’opération qui le rendra célèbre : Mar Verde. Cette nuit là, à bord de la Cassiopée, il ne veut rien laisser au hasard car il joue sa carrière et sa réputation de soldat.
Informations parcellaires
Les informations glanées lors de ce repérage autorisé par le commandant de la Défense maritime[5] permettent de réviser les cartes et de construire un modèle réduit du port. Pour Calvão ce n’est pas suffisant. Il crée une cellule de renseignement ad hoc chargée de collecter toutes les données disponibles : brochures touristiques, témoignages d’anciens du PAIGC, récits de guinéens exilés…[6] Il cherche toutes les photos possibles de Conakry, y compris sur des pochettes de disques[7].
L’information reste parcellaire. Des années plus tard, le chef de la délégation de la PIDE[8] Matos-Rodrigues confiera : « Nous n’avions pas d’agents dans les ambassades en Guinée Conakry ou au Sénégal, il n’y avait pas de réseau d’information (…) j’ai essayé d’envoyer un espion à Conakry mais il fallait trois mois pour avoir un visa[9] ». Trop tard, car la date de l’opération est déjà fixée.
Les autorités françaises ont elles contribué aux préparatifs portugais, ont-elles fourni du renseignement à Lisbonne ? À l’époque où l’opération est en cours de préparation, la diplomatie française tente plutôt un rapprochement avec le régime de Sékou Touré. Du 2 au 6 novembre 1970, une délégation française est à Conakry. L’une de ses missions est « d’établir un premier contact politique, dans le cadre du processus de rapprochement envisagé de part et d’autre. » Le compte-rendu établi suite à une rencontre avec Ahmed Sékou Touré indique que « la voie de la réconciliation est donc ouverte »[10].
Le compagnon de la Libération Pierre Clostermann, dans ses mémoires, affirme cependant avoir été amené à jouer un rôle dans cette opération. Il dit avoir été touché par la détresse d’une famille portugaise, les Ratos, dont l’un des petits-enfants se trouvait dans les mains du PAIGC à Conakry. Il affirme être allé rencontrer Jacques Foccart, conseiller Afrique du président français Pompidou : « Vieil ami et vieux complice, Foccart me reçoit dans son pigeonnier de l’Elysée, m’écoute avec attention et même un intérêt croissant, me dit que ce n’est pas de la tarte [sic] et me demande de revenir dans une dizaine de jours. » Il le rappelle en fait pour lui remettre « une enveloppe grand format épaisse qui contient une série de photos de Conakry renseignées et une carte de l’amirauté mise à jour des fonds le long de la ville et des plages » en échange de sa « plus totale discrétion ». Clostermann affirme avoir remis les photos à Spinola[11].
Calvão, dans son ouvrage « De Conakry ão MDLP », reste pour sa part flou sur la manière dont les plans ont été acquis. Antόnio Lobato quant à lui, doute fortement des dires de Clostermann : « Je n’ai le souvenir d’aucun détenu dénommé Ratos. Dans les faits, rien n’indique que le général de Spinola a reçu ces documents. Si tel avait été le cas, l’issue de l’opération aurait sans doute été différente[12] ».
Des armes, des mines et des uniformes
Août 1969 : Calvão rend visite à Spinola, en vacances dans la région du Luso[13], dans la métropole. Le général approuve l’idée de détruire la flotte et de libérer les prisonniers. Le chef d’état-major de la marine, le vice-amiral Armando de Roboredo acquiesce lui aussi et procure à Calvão un billet pour l’Afrique du Sud. Calvão s’envole pour Johannesburg en compagnie de Matos Rodrigues. Le chef de la délégation de la PIDE a de précieux contacts au sein du BOSS[14] qui les reçoit « de façon très accueillante[15] ». Tous deux reviennent à Lisbonne sur un vol de la TAP avec deux bagages à main remplis d’explosifs[16].
Pour assurer la discrétion de cette opération, les Portugais ont également besoin d’uniformes et d’armes qui ne soient pas les leurs mais qui ressembleront à ceux utilisés par les guinéens. L’URSS, qui dispose du matériel adéquat, « était le seul pays qui acceptait de nous vendre des armes rapidement »[17] affirme le major Carlos Azeredo.
Un discret jeu d’intermédiaires commence. Côté portugais, entre en scène José João Zoio, de la société Norte Importadora, qui fait appel au marchand d’armes français Georges Starckmann. Les deux hommes se connaissent bien comme le raconte le fils de Zoio: « Starckann avait déjà travaillé dans plusieurs opérations avec mon père. Ils étaient amis et il venait au Portugal régulièrement. »[18]
« Zoio [orthographié Zoyo dans le texte cité, NdlR] m’a reçu dans ses bureaux de Lisbonne et m’a exposé son projet, détaille Starckmann dans ses mémoires. Il cherchait à procurer aux services secrets de son pays, bien sûr le plus discrètement possible, un équipement militaire complet pour 300 hommes. Mais cet équipement était un peu particulier. Zoio voulait qu’il soit russe. Il était destiné à une opération très spéciale et secrète. »[19]
Pour répondre à la commande, le marchand d’armes français s’adresse à la Kintex, de Sofia, qui est l’un de ses fournisseurs habituels. Une entreprise qui évite les questions fâcheuses avec ses bons clients. « J’ai prétendu que le pays de destination était le Nigéria, ce que personne n’a eu le mauvais goût de vouloir vérifier, raconte Georges Starckmann. Contre paiement en dollars, la Kintex a mis à ma disposition tout le matériel à l’aéroport de Sofia. » Un avion loué à une compagnie belge se charge de transporter l’équipement.
Son plan de vol prévoit Lagos comme destination finale, Lisbonne comme escale. Starckmann précise : « Le matériel a été déchargé à Lisbonne par des militaires prévenus de l’arrivée de l’avion, puis rapidement transporté par camion dans un camp militaire près de Lisbonne, le tout sous contrôle militaire de la PIDE, la police internationale et de sûreté de l’État. »[20]
Le journaliste Antόnio Luis Marinho affirme, lui, que les armes sont transportées à Lisbonne dans un avion Air France avant d’être envoyées à Soga. Des caisses portent selon lui la mention « pour la police de l’Uruguay[21] » et contiennent 250 AK47, 12 RPG7, 20 mortiers de 82 millimètres ainsi que des minutions achetés pour un montant de 3 450 000 dollars. Le chèque est signé par un responsable des services de sécurité portugais.
L’enrôlement du FLNG…
À la fin de l’année 1969, Spinola informe Calvão que le ministère de l’Outre-mer a été approché par le FLNG, le mouvement des guinéens de l’extérieur qui souhaite renverser Sékou Touré[22]. « Depuis 1964 (…) Il cherchait logiquement à prendre contact avec nos autorités » précise Calvão[23]. Dans un premier temps, l’idée est d’installer la branche armée du FLNG sur le territoire portugais pour lancer des opérations vers la Guinée[24]. Mais le risque est jugé trop élevé, Spinola et Calvaõ optent pour le coup d’État. La décision sera confirmée des années plus tard dans une lettre de Spinola à l’état-major[25]. Le général détaille les objectifs de l’opération : appuyer le coup d’État, détruire les installations du PAIGC, puis capturer Cabral pour négocier un cessez le feu et enfin : libérer les prisonniers portugais.
L’opération, qui portera le nom de code de « Mar Verde » (mer verte), associera des fuzileiros portugais (l’équivalent des marines américains, créés en 1959 par l’Amiral Roboredo) et des éléments recrutés par le FLNG. Aidé de Matos Rodrigues, Calvao lance des opérations de contact dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest qui lui permettront de réunir 200 combattants[26]. Selon Marinho, un premier accord passé entre le FLNG et les autorités portugaises prévoit que le nouveau gouvernement « luttera contre les mouvements subversifs sur le territoire national »[27].
Une note dactylographiée rédigée par le chef politique du mouvement, l’ancien syndicaliste David Soumah, indique qu’« après deux rencontres à Lisbonne, c’est à partir du 21 décembre 1969 que les opérations [de soutien au FLNG] ont été effectivement commencées. Un premier versement de 50 000 dollars était destiné à la mise en place de trois comités et à leur fonctionnement : 1°) Comité politique 2°) Comité d’information 3°) Comité militaire ainsi qu’à la création des réseaux au Sénégal, en Gambie, en Sierra-Léone, en Guinée et au Mali.» La mise en place de ces structures était effectuée, selon cette note en janvier et février 1970[28].
Mais tout ne se passe pas comme prévu : le commandant Thierno Diallo, le responsable de la branche armée du mouvement, est arrêté à Dakar après l’interception, par la gendarmerie sénégalaise, d’un groupe chargé du recrutement dans la région de Kolda. Il est gardé quelques jours à la gendarmerie puis transféré au commissariat central. Conakry demande son extradition. L’épouse du commandant Diallo et l’un de ses plus proches amis, l’écrivain Camara Laye, font alors appel à l’ambassadeur de France au Sénégal. « Il s’est mis aussitôt en contact avec le ministre de l’Intérieur, détaille Diallo, en leur spécifiant que je suis un officier français résidant à Dakar sur ma demande. En conséquence, il demanda que je sois à sa disposition pour mon expulsion. Le gouvernement sénégalais ne pouvant faire autrement que d’accepter ordonna mon expulsion dans un délai de 48 heures. 24 heures après, un avion militaire venant de Paris a atterri à l’aéroport de Dakar pour me prendre et me ramener à Paris. » [29]
…malgré ses divisions
Pendant les préparatifs, Calvão fait plusieurs voyages à Paris et Genève, accompagné de Matos du PIDE, d’un exilé guinéen, Jean-Marie Doré ainsi que David Soumah, Moussa Keita, et Diallo Thierno[30]. Les hommes tentent de se mettre d’accord sur la répartition des postes au gouvernement mais les nombreuses ratures visibles sur le document reproduit par Marinho[31] attestent de la difficulté de parvenir à un consensus. Calvão les aide malgré tout à rédiger les déclarations qui devront être lues à la radio nationale[32].
Les ailes militaire et politique du FLNG sont également divisées. Au point de forcer le commandant Alpoim Calvão et le général Spinola à venir, en personne, à Paris en septembre 1970. Ils sont rejoints par David Soumah, arrivé de Dakar. Les deux officiels portugais ont un objectif : obtenir de Soumah et de Diallo qu’ils scellent leur réconciliation… Faute de quoi le gouvernement portugais cessera son soutien. Les retrouvailles ont été soigneusement mises en scène. Passé l’accord de principe donné par Diallo, Soumah, qui était dans une pièce adjacente se joint à la rencontre et donne l’accolade au chef de l’aile militaire de son groupe. « Après cette cérémonie de retrouvailles, se souvient le commandant Diallo, le gouverneur de la région de Guinée Bissau nous invite à déjeuner dans un grand restaurant des Champs-Élysées. Après cet excellent repas pris entre un groupe d’amis conjuguant leurs efforts pour atteindre un objectif, partagé en toute liberté, sans pression, nous nous sommes tous séparés. »[33]
Les autorités guinéennes en alerte
Le régime guinéen ne tarde pas à être au courant des préparatifs. Dans les pays voisins de la Guinée, les rebelles commettent plusieurs erreurs. En Sierra Leone, l’une des opérations est surprise par l’armée sur une plage et les combattants doivent abandonner deux canots pneumatiques[34]. Plus embarrassant encore : le 30 septembre, le groupe du FLNG en Gambie est arrêté. 38 hommes, parmi lesquels Mamadou Samba Diallo et Boubakar Ba. Les Gambiens révèlent l’information et on ne tarde pas à apprendre que ces hommes sont en train de préparer « une expédition pour renverser le régime Sékou Touré », qu’ils devaient être répartis en trois sections de dix, douze et seize membres et transportés par bateau en Guinée-Bissau, avant de gagner la Guinée. Condamnés en Gambie, les prisonniers sont envoyés vers Conakry[35].
Autre indice que le régime guinéen est bel et bien en alerte : fin septembre 1970, Ahmed Sékou Touré dénonce sur radio Conakry « l’existence en Guinée-Bissau de camps d’entraînement de ‘mercenaires guinéens’.»[36]
Le feu vert de Lisbonne
Autre contretemps, venu cette fois-ci de Lisbonne : début novembre les ministres de l’Outre-mer et de la Défense portugais, consultés par Spinola, s’opposent à l’opération[37]. Mécontent de leur réponse, ce dernier décide de s’adresser directement à la plus haute autorité du régime.
Le 14, Calvão se rend dans la capitale portugaise. Il porte une missive signée de la main de Spinola dans laquelle est écrit : « Pour ma part, j’assume l’entière responsabilité locale de son lancement [l’opération Mar Verde] en prenant des risques nécessaires, car je suis toujours fermement convaincu que, malgré les succès indiscutables déjà enregistrés dans le cadre de la contre-révolution sociale, nous perdrons la guerre si nous ne neutralisons pas l’ennemi de l’extérieur.[38] » Le destinataire n’est autre que le président du Conseil, Marcelo Caetano, le successeur de Salazar.
Ce dernier fini par recevoir Calvão le 16 et l’autorise à lancer Mar Verde à la condition que rien ne permette, à l’issue de l’opération, de mettre en cause le Portugal[39]. « J’ai parlé 5 minutes et il a dit : « Oui monsieur, allez-y » affirme Calvão[40]. L’officier rentre le soir même dans un DC-6 affrété spécialement pour lui[41]. Le 18, un avion de patrouille P2V-5 Neptune effectue une sortie de reconnaissance. Il confirme que les navires repérés sont toujours à Conakry et que la mer est calme.
Les doutes
De nouvelles troupes arrivent à Soga. Il s’agit des combattants venus de Guinée portugaise. Conformément aux consignes données par Calvão[42], les soldats qui sont à bord du navire de débarquement de type LDG (Lancha de Desembarque Grande) ignorent tout de la mission qui va leur être confiée. Ils ont embarqué à Chim, sont passés par Fa Mandinga. A défaut d’information précise, l’un de leurs officiers, João Januario Lopes a dit à ses hommes de se munir des vêtements nécessaires pour une expédition d’une quinzaine de jours[43].
Soga est à babord. Un message radio indique que les soldats ne pourront pas débarquer et que ceux qui sont à terre n’ont pas l’autorisation de prendre contact avec eux. Le mystère persiste. Le malaise s’installe. Puis vient l’ordre de débarquer, après quatre jours d’attente. Les hommes reçoivent pour consigne de laisser à bord leurs armes et uniformes portugais. Ils en recevront d’autres.
Les premiers soldats qui débarquent croisent sur le sol de Soga les combattants FLNG. Le bruit commence à courir qu’il faudra les accompagner chez eux. Certains éléments manifestent leur mécontentement[44].
Les réticences se propagent du côté portugais. Un gradé, le major Leal de Almeida manifeste ouvertement son opposition. « Par un étrange et inexplicable retournement de conscience, cet officier déjà informé de toute l’organisation du plan depuis près de 15 jours s’est mis à affirmer qu’il était contraire à l’éthique militaire d’attaquer un gouvernement contre lequel son pays n’est pas en guerre. » (…) « Cela a eu un effet délétère sur le moral des plusieurs éléments » déplore Calvão[45].
Des menaces sont lancées. Un officier arrêté pour insubordination, envoyé à Bissau, d’où il revient avec de meilleurs sentiments : « Ecoutez, dit-il à la troupe, nous n’allons pas rester ici ; tout ce que nous allons faire est de conduire ces gens de l’autre côté. Ensuite, nous les laisserons à eux-mêmes et rentrerons. La compagnie est tout de même capable de faire cela. Ceux d’entre vous qui refuseront seront mis en prison pour deux ans. »
La menace ne suffit pas à convaincre les réticents. Et si le régime de Sékou Touré lance des représailles ? Qu’adviendra-t-il des familles des soldats bissau-guinéens ? La confusion règne. Les officiers insistent : « Non, naturellement il n’y aura pas de difficultés. Tout ce que vous avez à faire c’est d’emmener ces gens là-bas.[46] » Le succès, expliquent-ils, est garanti et les chances de réussite sont de 95%.
Spinola intraitable
Un hélicoptère militaire en provenance de Bissau se pose sur l’île. Le général de Spinola pose le pied à terre, suivi du commandant Ibrahima Thierno Diallo, le chef de l’aile militaire du FLNG. Le lancement de l’opération est proche, une réunion de l’état-major est convoquée. Spinola expose à chacun sa mission. « Après avoir pris connaissance du plan d’opération, se souvient le commandant Diallo, j’ai demandé au général d’accepter que l’on porte quelques modifications en ce qui concernait les objectifs à atteindre. À mes yeux, si l’on ne rectifiait pas le plan, tel qu’il était conçu nous allions à l’échec. » Spinola lui oppose une fin de non-recevoir : pas question de modifier le plan, pas question de retarder le départ des troupes. Le moment de l’opération a été choisi en fonction des conditions atmosphériques, favorables à un débarquement. Spinola tente de mettre fin à l’échange : « Vous avez peur, mon commandant, de participer à la libération de votre pays ? ». Diallo campe sur sa position, renouvelle son avertissement. Sans succès[47]
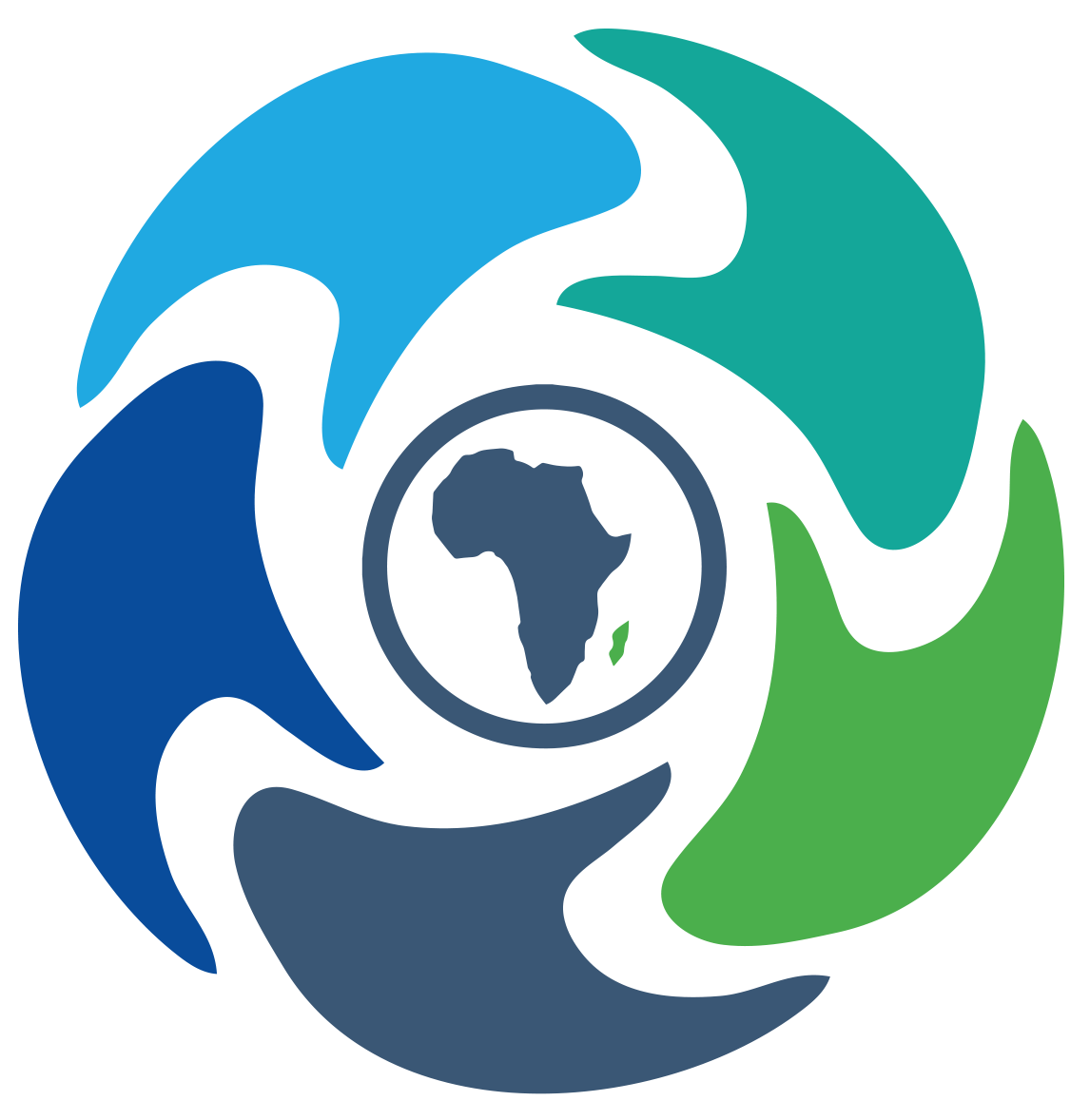



Les commentaires sont fermés.